Dans ses Mémoires publiées en 1997, le cardinal Ratzinger écrivait: «Nous avons besoin d’un nouveau mouvement liturgique, qui donne le jour au véritable héritage du concile Vatican II». C’est afin de répondre à cet appel qu’une vingtaine de personnalités catholiques (supérieurs de monastères, prêtres, évêques, journalistes, intellectuels catholiques) soucieux de donner l’impulsion à un renouveau d’intérêt pour la question liturgique, se réunirent à l’occasion d’un colloque qui s’est tenu en juillet 2001 à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault (Indre), sous la présidence du cardinal Ratzinger lui-même. Les différentes conférences prononcées à l’occasion de ce colloque ont été réunies en un ouvrage intitulé «Autour de la question liturgique», publié en novembre de la même année. La préface, rédigée par le T.R.P. dom Hervé Courau, abbé de l’abbaye Notre-Dame de Triors, rappelle les origines et les circonstances de l’événement, avant de tracer les grandes orientations qui devraient être celles de ce nouveau mouvement liturgique, dont l’émergence apparaît comme indispensable pour que l’Eglise d’Occident retrouve le sens profond et originel de la prière liturgique. Nous reproduisons le texte de cette préface ici, illustrée de quelques images d’une liturgie solennelle de la Pentecôte telle que célébrée à l’abbaye de Fontgombault .

« L’idée des Journées liturgiques de Fontgombault a germé à l’occasion de divers entretiens avec le Cardinal Ratzinger. Sa pensée, ainsi que le montre bien son livre récent L’Esprit de la liturgie, tourne souvent autour de l’idée d’un nouveau Mouvement liturgique, ou plutôt, d’un nouveau souffle pour « redynamiser » ce Mouvement sur lequel on avait fondé légitimement tant d’espoirs. On ne refait pas l’histoire et les chances gâchées ne se retrouvent pas. Le gros chantier de la réforme liturgique a besoin de stabiliser ses accotements: c’est du simple bon sens, avant d’être sagesse. Les déceptions du proche passé, si cruelles qu’elles puissent paraître, ne sont pas uniquement négatives, elles donnent aussi une leçon positive sur l’avenir: le Mouvement liturgique ne saurait être repris que sur des bases assainies, en faisant toujours davantage confiance à la Providence toute spéciale qui gouverne la Prière de l’Eglise: seule l’Esprit Saint est habilité à lui faire dire en vérité Abba-Père.

Le Cardinal ne souhaitait pas un débat devant les foules: le cadre de Fontgombault d’ailleurs ne s’y prêtait pas. Aussi fallait-il sélectionner un échantillon suffisamment représentatif de participants. En grande partie ce choix est dû au Cardinal lui-même. Il tenait à ce que les usagers des deux Missels romains de 1962 et de 1969 soient représentés à part égales.
Ces Journées se sont déroulées du 22 au 24 juillet 2001. Le dimanche 22, le cardinal chanta la sainte Messe (Missel de 1962) et donna l’homélie. En début d’après-midi, , après l’accueil des participants par le Père abbé de Fontgombault, Dom Antoine Forgeot, commencèrent les travaux proprement dits. La réflexion devait être conduite en quatre directions, ce qui donna quatre séries d’interventions dédoublées (conférence magistrale, puis applications plus concrètes): théologie de la liturgie, aspects anthropologiques de la liturgie, rite romain ou rites romains (ou quelle place pour la diversité dans la liturgie romaine?) et enfin les problèmes posés par la réforme liturgique et les leçons à tirer pour un nouveau Mouvement liturgique.

Ces diverses interventions ont été suivies de débats assez brefs, mais bien nourris. Un résumé de ceux-ci figure à la fin de cet ouvrage. Par ailleurs, trois laïcs sont intervenus, avant que le cardinal ne prononce la conférence de clôture. Puissions-nous y trouver lumière et courage pour oeuvrer humblement, chacun à sa place, dans le vaste champ de la Prière de l’Eglise.
Deux mots d’auteurs monastiques anciens me sont souvent revenus durant ces Journées: « Si tu pries, tu es théologien, si tu es théologien, tu pries » (saint Nil du Sinaï). « Le moine (entendez, le chrétien) commence à prier vraiment, quand il commence à ignorer qu’il prie » (saint Antoine le Grand). J’en rapproche le début de la 4e partie du livre du Cardinal: « Le très grand don de la foi chrétienne est de nous avoir fait connaître le juste culte ».

La devotio moderna (premier usage du mot moderne!) a consacré vers le XVe siècle un divorce entre liturgie et prière intérieure, livrant trop souvent cette dernière au risque de l’introspection, même si les écoles carmélitaine et ignatienne furent suscitées par la divine Providence pour diminuer ce danger. Dans le mouvement de pensée issu de Dom Guéranger et consacré par le Concile Vatican II (même si, hélas, un grand nombre de ses applications lui sont étrangères), la réflexion de ces Journées m’a paru s’orienter vers une devotio postmoderna, renouant avec la devotio antiqua, sans remettre en cause les apports de la théologie spirituelle du deuxième millénaire. Il s’agit de réunir à nouveau la liturgie intérieure et celle de l’Eglise-Epouse, dans la ligne des Pères et sans faire l’impasse sur le Moyen-Age qui a su y être fidèle: saint Thomas d’Aquin et le Concile de Trente sont ici des repères irremplaçables, a souligné le Cardinal.

Le troisième millénaire doit redresser ce qui a été gauchi au millénaire précédent, et cela sans cette prétention d’archéologisme réductrice, dénoncée par Mediator Dei, et dont les ravages n’ont pas été minces. L’unité avec l’Orient chrétien en particulier passe par cette réorientation de la liturgie latine, appelée à mieux goûter ses sources authentiques et à y être fidèle: on a trop confondu la noble simplicité avec des rites paupérisés.

Le vide de l’art sacré qui a suivi et l’absence d’intériorité masquant celle de la prière sont de graves symptômes qui appellent d’abord un cri vers Dieu afin que le don de la foi soit accordé abondamment aux âmes. Celle-ci rend docile à l’Esprit qui fait seul dire en vérité Abba-Père ».
Dom Hervé Courau, O.S.B.

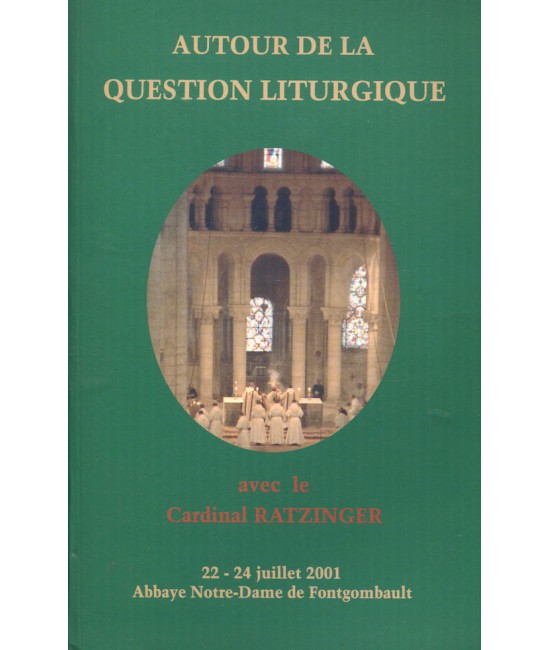

Laisser un commentaire