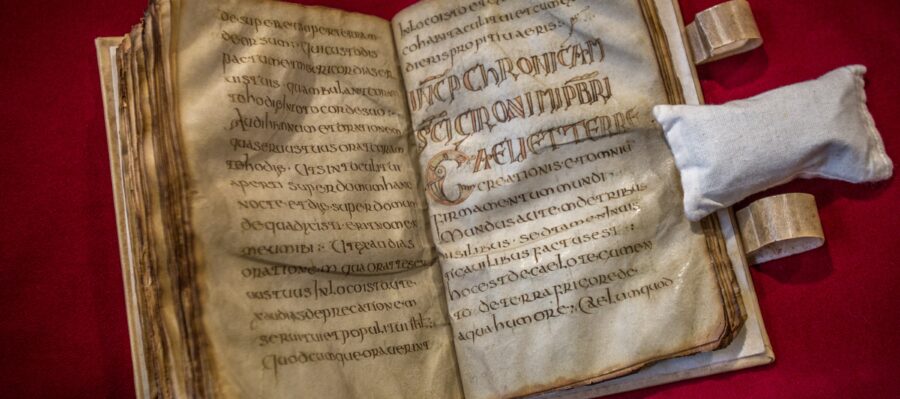On appelle couramment messe chantée, dans la forme extraordinaire du rite romain, une messe solennelle (avec encens) célébrée en l’absence du diacre et du sous-diacre. À l’origine, la messe chantée n’est qu’une messe basse qui n’est ni lue ni dialoguée, mais à laquelle on chante toutes les parties qui ne sont pas lue secrètement. Avec le temps, et grandement encouragée par les liturgistes des derniers siècles, est apparue la messe chantée avec encens.

Cette forme de messe, d’apparition relativement récente, est aujourd’hui la plus répandue, mais également celle où on observe le plus de changements d’une communauté à l’autre, d’un liturgiste à un autre. Cet article s’efforcera de donner les différentes variations de cette messe, selon les règles du Missel Romain de 1962.
Une messe chantée requiert la présence de quatre servants pour accompagner le prêtre : deux acolytes, un thuriféraire dont le rôle est de porter (fero en latin) l’encens (thuris), et un cérémoniaire, auquel ce premier article est directement consacré. Afin de solenniser certaines fête, et pour donner l’opportunité aux garçons de se rapprocher de l’autel, il existe d’autres fonctions qui peuvent être accomplies par des jeunes moins expérimentés, comme les céroféraires (au nombre de 2, 4, ou 6, parfois 8) et le porte-navette. Dans de nombreux lieux, on rajoute un porte-croix, qui se placera entre les deux acolytes lors de la procession d’entrée et de retour à la sacristie.
Le rôle du cérémoniaire est d’assurer l’exécution correcte et digne de la cérémonie ; il veillera donc à ce que les ministres accomplissent convenablement leur rôle, n’hésitant pas à les reprendre discrètement s’ils commettent des erreurs. C’est également à lui que revient la tâche de corriger le prêtre si celui-ci se trompe, et de lui indiquer ce qu’il doit faire si celui-ci a une hésitation. Il veillera de même à la cohésion des mouvements d’ensemble. Pour cela, il claquera des mains un coup à chaque fois que les ministres doivent génuflecter ou se lever, et deux coups pour s’agenouiller. Ce signal doit être assez fort pour être entendu de tous, tout en demeurant discret.
À la sacristie, le cérémoniaire aide le célébrant à revêtir les ornements. Il donne ensuite le signal du départ de la procession. Il marche devant le prêtre si celui-ci est en chasuble, ou à sa droite si celui-ci porte la chape. (c’est d’ailleurs la règle générale lorsque le cérémoniaire accompagne le célébrant). Il aide le prêtre à monter toutes les marches qu’il rencontre en soulevant le bas de l’aube. En entrant dans le cœur, il vient se placer à droite du prêtre au pied des marches, ou à gauche si on chante l’Asperges me. Durant l’aspersion, le cérémoniaire se place toujours à gauche du célébrant en passant toujours devant lui lorsqu’il doit échanger de côté avec le thuriféraire pour se retourner. Il est aspergé à genoux s’il est aspergé juste après l’autel, et debout profondément incliné s’il est aspergé après les fidèles. Lorsque le prêtre est de retour à l’autel après l’aspersion, le cérémoniaire lui présente la feuille pour l’oraison. Le cérémoniaire accompagne le célébrant à la banquette, lui ôte la chape qu’il donne au thuriféraire, et aide le prêtre à revêtir le manipule et la chasuble. Ils retournent alors tous les deux au pied de l’autel.
Le cérémoniaire fait la génuflexion en même temps que le prêtre et s’agenouille à la droite du prêtre, répondant aux prières au bas de l’autel. Après celles-ci, il fait lever tout le monde, et se rend à la gauche du thuriféraire, côté épître en bas des marches, qu’ils montent ensemble après avoir salué le prêtre une fois que le cérémoniaire a reçu la navette du thuriféraire. En haut du marchepied, le cérémoniaire ouvre la navette et donne la cuillère au prêtre (à chaque fois qu’il donne quelque chose au prêtre il embrasse d’abord l’objet puis la main du prêtre). Il demande ensuite au prêtre de bénir l’encens en disant la phrase suivante « Benedicite pater reverende » (bénissez, révérend père) ; lorsque le prêtre la lui rend, il récupère la cuillère (à chaque fois que le prêtre lui donne un objet, il embrasse d’abord la main, puis l’objet). Il rend ensuite la navette au thuriféraire, et celui-ci lui passe l’encensoir. Le cérémoniaire vient se placer à droite du prêtre et lui donne l’encensoir (avec baisements). Il accompagne les mouvements du prêtre, et lui soutient le coude en génuflectant. Si la forme de la chasuble gêne les mouvements du prêtre, il la soutient légèrement pendant l’encensement. L’autel encensé, il reçoit l’encensoir (avec baisements), descends in plano (i.e. en bas des marches) côté épître, se tourne vers le prêtre, et l’encense trois fois deux coups, s’inclinant profondément avant et après. Il rend alors l’encensoir au thuriféraire, et monte au côté épître de l’autel, « au missel », à droite du prêtre.
Le cérémoniaire indique au célébrant de la main droite l’antienne d’introït. Il se signe et s’incline avec lui au Gloria Patri, puis répond au Kyrie. S’il a le temps, il indique au prêtre de s’asseoir. Ils se rendent à la banquette par le chemin le plus bref, sans inclinaison ni génuflexion. Le cérémoniaire arrange la chasuble sur la banquette, à moins que la disposition des lieux rendent cette tache plus facile aux acolytes. Il donne la barrette au prêtre, puis il se place debout face aux fidèles, à la droite du célébrant, ce qui sera sa position habituelle lorsque celui-ci est à la banquette. Au dernier Kyrie, il fait, d’une inclinaison de tête, signe au prêtre de se découvrir et de se lever, et récupère la barrette, et l’accompagne à l’autel pour qu’il y arrive à temps pour le Gloria ou la collecte. Ils retournent à l’autel par le milieu, où le cérémoniaire fait la révérence appropriée à la Croix avec le célébrant avant que celui-ci ne monte à l’autel.
S’il y a un Gloria, le cérémoniaire vient ensuite se placer en bas des marches, légèrement sur la droite, face au troisième cierge. (Si le prêtre n’était pas allé s’asseoir, le cérémoniaire se tourne sur sa droite, puis il descend et fait le tour des marches pour venir à sa place) il fait les inclinaisons de tête vers la Croix pendant le Gloria (aux mots « Deo », « adoramus te », « gratias agimus tibi », « Jesu Christe », « suscipe deprecationem nostram » et « Jesu Christe »). Lorsque le prêtre a fini de réciter le Gloria, ils vont à la banquette, toujours par le chemin le plus court et sans génuflection ou inclinaison. Il fait à la croix d’autel les inclinations profondes qui conviennent pendant le chant du Gloria (en s’inclinant avant vers le prêtre pour qu’il se découvre). À la fin du Gloria, il fait le signe de croix et s’incline vers le prêtre, puis ils retournent à l’autel.

Le cérémoniaire monte au missel et indique au célébrant la collecte, et les éventuelles mémoires. À la fin de la dernière oraison, il descend à la crédence chercher le lectionnaire (si besoin), puis remonte au missel. Si le prêtre souhaite lire la traduction de l’épître à ce moment, le cérémoniaire lui donne le lectionnaire ouvert à la bonne page. Le prêtre récite ensuite le Graduel, l’Alléluia, l’éventuelle séquence ou le trait. Ils vont ensuite s’asseoir comme précédemment. Au début de l’Alléluia (lorsque la schola chante alléluia pour la deuxième fois) ou pendant la séquence ou le trait, il fait signe au prêtre de se lever et l’accompagne à l’autel. Arrivé au pied des marches, il aide le prêtre à les monter, puis appelle le thuriféraire pour imposer de l’encens (qui se déroule exactement comme la première). À la fin de l’imposition, le thuriféraire récupère la navette et garde l’encensoir. Le cérémoniaire prend le missel, et descend se placer au pied des marches à droite du thuriféraire. Lorsque la schola reprend « Alléluia » (ou à la fin de la séquence ou du trait), tous génuflectent au signal du cérémoniaire. Puis, le cérémoniaire monte poser le missel côté Évangile, et redescend à droite du thuriféraire.
Au Dominus vobiscum qui précède l’Évangile, le cérémoniaire récupère l’encensoir dans sa main droite, et monte le présenter au prêtre, avec baisements, pour l’encensement du missel. S’il y a une inclinaison à faire au début de l’Évangile, il attendra cette inclinaison pour redescendre des marches. Il rend ensuite l’encensoir au thuriféraire, et reste ici jusqu’à la fin de l’Évangile. Si le prêtre le lui tend, il récupère le lectionnaire qu’il va poser à la crédence lorsque tous ont fait la génuflexion au pied des marches à son signal.
Il est interdit d’encenser ici le célébrant à la messe chantée (cf Ritus Servandus, VI, 8) ; en effet, le diacre à la messe solennelle encense l’officiant (qui n’est d’ailleurs par toujours le célébrant, mais peut être un prélat assistant à la messe depuis son trône), pour lui rendre grâce de l’avoir missionné pour annoncer l’Évangile. Mais le célébrant qui proclame lui même l’Évangile ne doit pas s’encenser ou se faire lui même encenser, pour se rendre grâce à lui même.
Si le prêtre donne une homélie, le cérémoniaire va s’asseoir à côté de la banquette ou accompagne le prêtre à la chaire. S’il y a un Credo, il vient se placer in-plano face à l’autel, côté épître. Lorsque le prêtre a fini de réciter le Credo, ils vont à la banquette après avoir fait la révérence appropriée au milieu. Le cérémoniaire se met à genoux au chant du « et incarnatus est » si le prêtre a fini de réciter le Credo ; si le prêtre n’est pas encore assis, ils s’agenouillent au pied des marches, sinon, le cérémoniaire s’agenouille à côté de la banquette où le prêtre est assis, après lui avoir fait signe de lui-même s’incliner. Le célébrant assis, le cérémoniaire prend à la crédence le calice et l’apporte à l’autel ; il y déplie le corporal, pose le calice dessus, et rapproche le missel. Puis il retourne à la banquette. S’il n’est pas clerc, il prendra soin d’attraper le calice par le voile pour ne pas le toucher ; on pourra également, en ce cas, laisser le calice posé sur l’autel dès le début de la messe. À la fin du Credo, il fait signe au prêtre de se découvrir et de se lever, puis il l’accompagne à l’autel, où il monte par le milieu.
À l’Oremus de l’offertoire, le cérémoniaire apporte le calice s’il ne l’a pas encore fait (absence de Credo). Puis il plie le voile de calice que lui passe le célébrant, et redescend à sa place. Lorsque le prêtre s’incline sur les oblats (In spiritu humilitatis), le cérémoniaire appelle le thuriféraire pour l’imposition de l’encens, qui se déroule comme au Kyrie. Puis le cérémoniaire rend la navette au thuriféraire, et reçoit l’encensoir qu’il donne au prêtre avec les baisers. Il assiste ce dernier à sa droite pendant l’encensement, soutenant le coude à chaque génuflexion et la chasuble si nécessaire. À la fin de l’encensement de l’autel, le cérémoniaire reçoit du célébrant l’encensoir, descend in-plano, et l’encense de trois coups doubles, s’inclinant profondément avant et après. Ayant rendu l’encensoir au thuriféraire, le cérémoniaire fait le tour des marches, génuflecte au pied de l’autel et monte directement au missel.
Il répond à l’Orate fratres, indique la secrète et les éventuelles autres oraisons au célébrant, puis met le missel à la page de la préface. Le cérémoniaire se tourne vers le thuriféraire au moment opportun pour se faire encenser, le saluant avant et après d’une inclinaison de tête. Quand le célébrant achève la récitation du Sanctus, le cérémoniaire met le missel à la page du Canon.

Pendant le canon, le cérémoniaire reste au missel, tournant les pages quand il le faut. Au Memento des vivants, il se retire légèrement, et se rapproche quand le célébrant étend à nouveau les mains. Au « Quam oblationem », ou plus tard s’il lui faut encore tourner la page avant les paroles de la consécration, le cérémoniaire s’agenouille sur le marchepied. Il soulève légèrement la chasuble du célébrant à chaque élévation, et se relève avec lui après la dernière génuflexion. Il assiste de nouveau le célébrant au missel, tournant les pages quand il le faut. Lorsque le célébrant génuflecte, le cérémoniaire fait de même, soutenant légèrement le coude du célébrant. Au Memento des morts, il se retire comme pour le Memento des vivants. Il reste ainsi au missel jusqu’aux prières précédant la communion.
Au premier Domine, non sum dignus du célébrant, le cérémoniaire descend s’agenouiller in plano au côté Évangile, face à l’Orient. Il reste ainsi jusqu’à l’Indulgentiam qui suit le Confiteor (récité par le 1° acolyte). Quand le célébrant se retourne vers l’autel pour prendre le ciboire, le cérémoniaire et les autres ministres se lèvent. Tous se mettent en ligne au pied de l’autel. Ils génuflectent, montent et s’agenouillent sur le marchepied pour communier. Le cérémoniaire, qui est à l’extrémité côté Évangile, communie le dernier. Il garde le plateau avec lui, se lève et accompagne le célébrant pour la distribution de la communion. Celle-ci achevée, il précède le célébrant à l’autel, lui donne le plateau de communion, et s’agenouille au pied des marches, côté épître.
À la fermeture du tabernacle, il fait signe aux servants de se lever, puis il reste au pied des marches pendant les ablutions. Il monte au côté épître lorsque le 1° acolyte y a déposé le missel, et indique au célébrant l’antienne de communion quand celui-ci vient la réciter. Il reste au missel pendant le Dominus vobiscum puis indique la postcommunion et les éventuelles autres oraisons. L’oraison chantée, il ferme le missel (tranche vers la croix), prend le carton de l’Ite missa est si besoin, et descend par le côté épître le présenter au célébrant.
Quand celui-ci l’a chanté, il génuflecte au milieu et s’agenouille au pied de l’autel. Après avoir reçu la bénédiction, il monte au côté évangile de l’autel. Il est préférable que le cérémoniaire ne tienne pas le canon pendant le dernier évangile, cette fonction étant réservée au sous-diacre. Après avoir répondu Deo gratias, il vient prendre place au pied de l’autel, de telle sorte qu’il soit à la droite du célébrant pour la génuflexion finale. Il précède le célébrant à la sacristie, où il donne le signal du salut à la croix, salue l’évêque si celui-ci est présent, puis le célébrant et demande la bénédiction au plus digne en disant : « Jube domne benedicere« . Il aide enfin le célébrant à quitter les ornements.