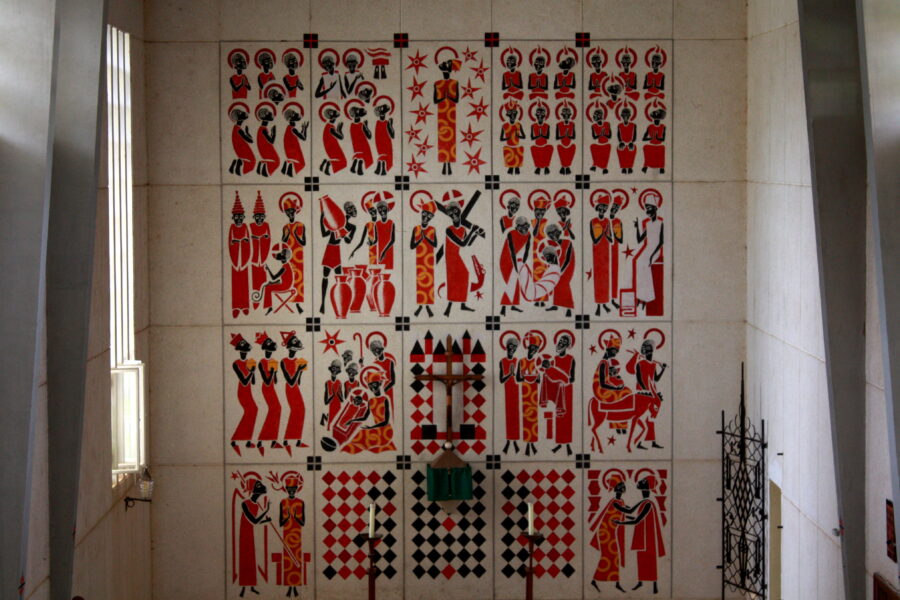Keur Moussa est une abbaye bénédictine fondée dans les années 60 à Keur Moussa dans l’Ouest du Sénégal qui compte aujourd’hui une trentaine de moines. L’abbaye est reconnue principalement pour son chant et sa musique liturgiques qui s’inscrivent profondément dans le principe d’inculturation et pour sa revitalisation d’un instrument de la culture mandingue, la kora.
Habituellement le terme d’inculturation désigne la transmission du message kérygmatique en fonction de la culture du pays (par exemple saint Paul à l’Aéropage) mais le terme est de plus en plus couramment utilisé de manière analogique pour désigner l’adaptation de l’expression rituelle de la Foi, la liturgie.
Ce principe d’inculturation du chant est explicitement cité ainsi : « 6. Le chant et la musique requis par la réforme liturgique – il est bon de le souligner – doivent également répondre aux exigences légitimes de l’adaptation et de l’inculturation. Il est toutefois clair que toute innovation dans cette matière délicate doit respecter des critères précis, tels que la recherche d’expressions musicales qui répondent au besoin d’impliquer l’assemblée tout entière dans la célébration et qui évitent, dans le même temps, de céder à la légèreté et à la superficialité. »
Pourquoi prendre Keur Moussa pour exemple ? parce que notre foi et notre rite romain ne connaissent pas de frontières et nous y trouvons un parfait et rare exemple d’adaptation du trésor liturgique à la culture environnante. Et la question que j’aimerais que nous nous posions : en quoi la musique de Keur Moussa est-elle plus liturgique et mieux inculturée que nos cantiques contemporains ?
eh bien j’y vois trois raisons:
Tout d’abord le texte, les chants de Keur Moussa repose sur les Saintes Écritures, comme le chant grégorien, le chant de cette abbaye ne s’éloigne pas de la parole de Dieu, il s’y attache et y trouve un ancrage pour sa composition, il tire des paroles évangéliques sa force mélodique.
Saint Jean Paul II dit à ce propos : « 3. En diverses occasions, j’ai moi-même rappelé la fonction précieuse et la grande importance de la musique et du chant pour une participation plus active et intense aux célébrations liturgiques, et j’ai souligné la nécessité de « purifier le culte d’erreurs de style, de formes d’expression médiocres, de musiques et de textes plats, peu adaptés à la grandeur de l’acte que l’on célèbre » , pour assurer la dignité et la beauté des formes de la musique liturgique. »
La deuxième raison est sa proximité avec la manière de chanter le grégorien dans une partie de ses compositions (Keur Moussa est une fille de Solesmes, rappelons-le) cela en conformité avec l’enseignement récent de l’Eglise sur la musique sacrée.
Et la dernière raison, sa stricte inculturation, la musique de l’abbaye n’use d’aucun artifice moderne ou occidental pour être jouée, vous n’entendrez aucun synthétiseur, aucune guitare, uniquement les instruments que l’on retrouve dans la musique traditionnelle sub-saharienne. Le mélange surprenant mais intelligent du chant avec une rythmique propre à la culture de l’Afrique de l’Ouest est réussi car il correspond à un mode d’expression soit solennel, soit joyeux ou contemplatif et permet réellement d’entrer dans une attitude de prière qui sied à la liturgie.
Voici quelques exemples concrets et en premier une pièce de l’ordinaire, un Agnus Dei en langue wolof dont voici les paroles:
Mburtum Yalla mi di dindi baakari adduna,
yërëm nu
Mburtum Yalla mi di dindi baakari adduna,
yërëm nu
Mburtum Yalla mi di dindi baakari adduna,
may nu jamm
Un deuxième exemple avec un accompagnement instrumental :
Et un dernier exemple avec un accompagnement à la kora :
Si vous désirez approfondir vos connaissances à ce sujet, voici un court article écrit par le Père Olivier-Marie SARR osb : https://www.academia.edu/