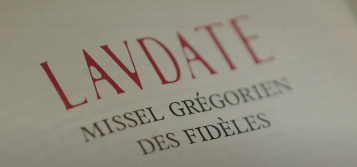En collaboration avec la maison d’édition Artège
Lien pour acheter le missel Laudate: https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/laudate
Les plus anciens se rappellent sans doute des missels des fidèles dont la première moitié du XXe siècle fut l’âge d’or. Des livres comme les « Dom Lefebvre » et « Maredsous » demeurent pour beaucoup d’entre nous de précieuses ressources.
L’essort de ces missels fut freiné avec la réforme liturgique. Beaucoup se disaient qu’ils ne se justifiaient que par l’exclusivité du latin dans la liturgie. Pourquoi tenir dans ses mains ce que l’on entend désormais dans sa langue ? Si quelques missels des fidèles furent publiés depuis, ils n’ont pas grand-chose en commun avec leurs prédecesseurs, dans la forme ou dans le fond ; en particulier, la tradition proprement latine, le propre de la Messe par exemple, brille par son absence.
Il manquait donc un missel qui pût réconcilier la réforme liturgique et la tradition des missels des fidèles. C’est ce manque que le missel grégorien Laudate, préparé par une équipe de laïcs et de prêtres (de la Communauté Saint-Martin pour l’essentiel), entend combler.
Avant d’examiner cet ouvrage en détail, notons que contrairement à ce que son titre complet pourrait indiquer, ce missel n’est pas tout à fait « grégorien », dans la mesure où il ne contient pas les partitions permettant de chanter la Messe (contrairement à l’excellent « Missel grégorien » de Solesmes, qui ne contient cependant pas les lectures), mis à part quelques exceptions sur lesquelles nous reviendrons plus bas.
Ce qui frappe au premier abord, c’est la beauté de l’ouvrage. Sa couverture noire (ornée d’une superbe enluminure dans l’édition standard), la dorure de ses pages (dans l’édition cuir), les illustrations, la présentation des textes confèrent au tout un aspect à la fois sobre et élégant.
Le livre est divisé en quatre parties. D’abord, le propre de chaque Messe, à savoir les oraisons (dans l’original latin et la traduction officielle nouvellement promulguée) et le propre grégorien : introïts, graduels, offertoires… accompagnés d’une traduction, celle-ci à usage privé, non liturgique (nous y reviendrons). Chaque Messe (à l’exception des féries de l’Avent et du Carême) est précédée d’une présentation et d’une méditation puisant dans les textes de la tradition grégorienne. Cette démarche, explicitement revendiquée dans l’introduction, éclaire tout l’ouvrage : il ne s’agit pas seulement de se laisser nourrir par les péricopes bibliques, comme le proposent les missels déjà existant, mais d’assimiler cette nourriture à l’aide de la liturgie et la tradition. On y retrouve donc deux fonctions essentielles de la liturgie : la formation des fidèles et le modèle de la foi, selon l’adage bien connu : lex orandi, lex credendi (la loi de la prière est la loi de la foi). Une deuxième partie, beaucoup plus courte, comprend l’ordinaire de la Messe, là encore en latin et français ; sont également indiquées les préfaces et un choix de textes pour la prière des fidèles.
La troisième partie comprend les lectures et les chants indiqués au lectionnaire (sauf pour quelques grandes fêtes, où ces lectures sont données en première partie). Assurément, faire tenir toutes les lectures de la liturgie rénovée en un seule livre était un défi de taille ; mais les rédacteurs du Laudate l’ont relevé en se limitant aux lectures du temporal, sauf lorsque le sanctoral indique des lectures propres obligatoires. Choix discutable, mais conforme à la nécessité autant qu’à la pratique habituelle. Esthétiquement, la présentation des lectures est un peu moins agréable que celle des textes propres (chants et oraisons) de la première partie.
La quatrième et dernière partie est un ensemble de prières, d’enseignements et de dévotions, allant des sacrements aux offices du dimanche en passant par le rosaire, le chapelet de la miséricorde et autres litanies. Un très riche ensemble de textes, dans la lignée, là encore, des anciens missels des fidèles, et où ceux-ci puiseront avec profit de quoi nourrir leur vie spirituelle. Une sélection de partitions d’ordinaires grégoriens pour l’année cloture l’ouvrage.
Puisque nous parlons des partitions, c’est le moment d’évoquer un point qui pourra passer pour un défaut : elles sont en notation moderne et non en notation grégorienne. Cela choquera les puristes et laissera les autres indifférents. Pour notre part, sans condamner ce choix, sans même y voir un défaut, nous nous interrogeons sur sa pertinence : après tout, la notation grégorienne n’est pas plus compliquée que la moderne et sa présence aurait pu constituer une porte d’entrée vers l’univers du plain-chant.
Si ce point n’est pas forcément un défaut, le Laudate contient tout de même des imperfections bien réelles ; si l’honnêteté nous oblige à les indiquer, elle nous intime aussi de préciser qu’elles sont très peu nombreuses et de faible importance. Quelques traductions discutables sont à déplorer (ainsi ne comprend-on pas pourquoi les traducteurs ont choisi de rendre « Beati » par « Heureux » quand « Bienheureux » semblait mieux indiqué) dans les textes français du propre ; la part laissée à l’office divin est trop faible (il eût été approprié d’insérer au moins les antiennes du Benedictus et du Magnificat des dimanches et fêtes de l’année) ; quelques coquilles sans importance pourraient être détectées ça et là.
On pourra aussi juger étrange le choix d’indiquer les lectures à part du propre chanté et des oraisons ; sans doute ne voulait-on pas grossir à l’infini un livre déjà volumineux. Mais ceci nous indique un des objectifs de ce missel, celui de distinguer la « Messe grégorienne » (chantée en grégorien) et la Messe « normale ou dialoguée ». Cet objectif semble clair si l’on se réfère aux multiples allusions à la beauté de la Messe grégorienne distinguée de « l’autre Messe ». Ainsi, à la présentation du lectionnaire : « Les deux systèmes du Graduel romain et du lectionnaire romain ayant chacun leur logique propre, ils ne peuvent être combinés sans dommage pour la liturgie » (page 1047) ; ou bien : « les textes des chants grégoriens ont fait l’objet d’une traduction libre qui n’est pas destinée à être lue dans la liturgie » (page 8), etc. autant de citations qui semblent tracer une barrière entre la liturgie connue des fidèles et celle des communautés de Solesmes, Kergonan, Saint-Wandrille et Evron.
Ce but nous semble très critiquable. Outre qu’il semble un peu artificiel (après tout, il s’agit non seulement du même rite, mais de la même forme rituelle, la forme ordinaire du rite romain), il paraît surtout dangereux. Si l’on présente la liturgie grégorienne comme une réalité à part de la liturgie habituelle, pourquoi les pratiquants de la seconde feraient-ils un pas vers la première ?
Cette petite réserve mise de côté, le Laudate n’en demeure pas moins un ouvrage exceptionnel, aussi inattendu que bienvenu, auquel nous souhaitons le plus grand succès.