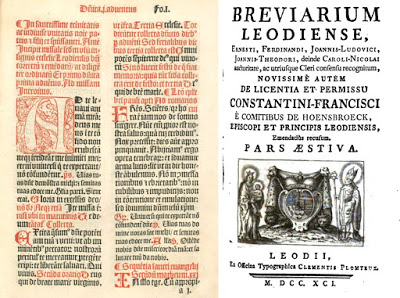Note d’Esprit de la Liturgie : Nous proposons dans ce qui suit, avec la permission de l’auteur, une traduction d’une tribune de Dom Alcuin Reid O.S.B. , publiée le 6 août dernier dans le journal catholique en ligne Catholic World Report. Dom Alcuin Reid est historien de la liturgie, spécialiste du Mouvement Liturgique et des réformes du rite romain au XXème siècle. Il est également le prieur du Monastère Saint-Benoît de Brignoles, une communauté bénédictine de droit diocésain du diocèse de Fréjus-Toulon

Dans le brouhaha qui a suivi la promulgation du Motu Proprio Traditionis custodes le 16 juillet, nous avons eu droit à un torrent de commentaires de la part des vainqueurs. Ceux-ci déforment tant l’Histoire de la liturgie qu’on ne peut s’empêcher de les comparer aux journalistes les moins scrupuleux qui encensent de commentaires révisionnistes leur candidat favori le matin après sa victoire dans une élection quelconque. Ne prétendons pas maintenant qu’il s’agit d’autre chose que d’une guerre politique ecclésiastique, aussi perturbante que soit cette réalité – d’autant plus qu’il y a trois semaines, la tolérance liturgique, à défaut d’une vraie paix, s’était enracinée, avait grandi et porté ses fruits dans de nombreux diocèses, sinon la plupart.
Le pape François est “revenu avec force aux paroles de Vatican II a dit et les a appliquées », nous dit-on. « Une partie de ce que Benoît XVI a fait était contraire au Concile Vatican II », affirme-t-on encore. « L’Église tout entière reviendra à la messe de 1970 « , claironne-t-on. On dit allègrement que « le missel de 1970 » est « en un sens supérieur, plus fidèle à la volonté du Seigneur telle qu’elle est comprise par le Concile Vatican II ». La « participation active » à la liturgie et la liturgie de Vatican II « sont synonymes », assène-t-on. Nous devons être soulagés que les éléments « médiévaux » corrompus de la liturgie aient été écartés une fois pour toutes.
De même, le tout premier article du Motu Proprio lui-même, qui cherche à établir les livres liturgiques modernes comme « l’unique expression de la lex orandi du rite romain », trahit une compréhension fondamentalement défectueuse de l’histoire de la liturgie, de la relation entre la lex orandi et la lex credendi et du pouvoir de ceux dont le ministère dans l’Église est effectivement de veiller sur sa Tradition vivante.
Une corruption de la liturgie ?
Il convient donc de récapituler quelques éléments fondamentaux de l’histoire de la liturgie [1].
Commençons par la supposée « corruption » médiévale de la liturgie – une théorie très en vogue chez les liturgistes du milieu du XXe siècle et largement propagée par leur doyen, Joseph A. Jungmann, SJ. Selon cette théorie, la liturgie « pure » de l’Église primitive a été corrompue à l’époque médiévale et surchargée d’éléments inappropriés. Sur la base de cette hypothèse, les réformateurs du vingtième siècle ont cherché avec ardeur à supprimer les accrétions illégitimes et à revenir à une liturgie antérieure à cette corruption, qu’ils ont rendue à nouveau disponible par la réforme liturgique de saint Paul VI.
Cette théorie, parfois appelée « archéologisme », dénigre toutes les formes liturgiques qui se sont développées dans la vie de l’Église depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Renaissance – soit environ mille ans – niant la possibilité que le Saint-Esprit puisse inspirer des développements légitimes de la liturgie au cours de cette période. Elle est stupéfiante d’arrogance, mais très utile comme outil politique. Au final, même Paul VI résista à ses implications les plus dures, en refusant les demandes des liturgistes d’abolir le canon romain, le Confiteor, l’Orate Fratres, etc. (On pourrait cependant arguer qu’ils ont été pratiquement abolis en devenant de simples options, ou en étant mal traduits, mais c’est une autre question).
Si la théorie de la corruption de Jungmann était l’erreur fondamentale qui sous-tendait l’oeuvre des réformateurs du milieu du vingtième siècle, les opinions convenues des pontes liturgiques de notre époque partent toutes du principe que la participation active à la liturgie d’un côté, et à la liturgie de Vatican II (c’est-à-dire les livres liturgiques promulgués par Paul VI) de l’autre, sont une seule et même chose. Eh bien, non, elles ne le sont pas.
Tout d’abord, le fait que la liturgie soit « la source première et indispensable d’où les fidèles doivent tirer le véritable esprit chrétien » et qu’une véritable participation à celle-ci soit essentielle pour tous a été affirmé par saint Pie X en 1903 et réitéré par ses successeurs jusqu’au Concile. En outre, cette affirmation de 1903 a donné naissance à ce que l’on a appelé le mouvement liturgique du XXe siècle, qui s’est consacré à la promotion de la participation réelle à la liturgie telle qu’elle était à l’époque (c’est-à-dire ce que l’on considère aujourd’hui comme l’ancienne forme du rite romain – l' »usus antiquior« ). Des décennies de travail s’ensuivirent, au cours desquelles des pasteurs et des universitaires amenèrent diligemment le peuple chrétien à découvrir et à s’abreuver profondément à cette source primaire et indispensable de l’esprit chrétien, comme base de leur vie quotidienne.
Il est vrai que, ce faisant, certains en sont venus à croire que cette véritable participation pourrait être facilitée par une réforme liturgique – une introduction limitée de la langue vernaculaire, par exemple. En conséquence, certaines réformes ont été adoptées, à partir des années 1950. C’est dans ce contexte que le Concile Vatican II – un Concile œcuménique de l’Église à la légitimité incontestable – a jugé avec autorité qu’il convenait de demander un développement organique du rite romain, une réforme modeste permettant d’atteindre les nobles objectifs pastoraux que la Constitution sur la Sainte Liturgie expose dans son premier paragraphe.
Il est également vrai que certaines voix à l’époque, et dans les années 1950, ont trahi une mauvaise compréhension de la nature de la liturgie, cherchant à l’adapter presque complètement à l’image et à la ressemblance et aux besoins supposés de « l’homme moderne », évacuant ainsi son contenu même et la transformant en quelque chose de plus proche du culte protestant. Certains liturgistes, de nombreux jeunes clercs, religieux et laïcs trop enthousiastes, et même un ou deux Pères du Concile ont surfé sur cette vague de « créativité » liturgique. Ces théories et ces « abus » pratiques sont moins fréquents aujourd’hui, mais ils ont causé des dommages incalculables.
Vatican II et l’application de la réforme
Au milieu de tout cela, le groupe officiel chargé de mettre en œuvre la réforme du Concile (le « Consilium »), que ce soit par enthousiasme, par pure opportunité ou par conviction sincère que c’était pour le bien de l’Église (ou une combinaison de ces facteurs), est allé bien au-delà de la réforme envisagée par le Concile et a produit des rites qui devaient plus aux désirs des acteurs-clés du Consilium qu’aux principes de la Constitution du Concile sur la Sainte Liturgie. Où le Concile a-t-il demandé de nouvelles prières eucharistiques ? Où a-t-il autorisé la vernacularisation à 100% des rites liturgiques ? On pourrait énumérer d’autres exemples. Le secrétaire du Consilium, le Père Bugnini lui-même, se vante dans ses mémoires d’avoir dépassé le mandat du Concile.
Il est ici crucial de relever qu’une distinction légitime peut être faite entre le Concile et la réforme mise en œuvre en son nom. S’interroger sur la continuité des livres liturgiques modernes avec la tradition liturgique, et avec les saint principes posés par le Concile, ce n’est pas nier le Concile ou son autorité. C’est plutôt chercher à défendre le Concile contre ceux qui ont déformé ses intentions manifestes.
Néanmoins, comme il ressort clairement de ses discours publics de l’époque, Paul VI était personnellement convaincu en 1969/1970 que les changements supplémentaires apportés aux livres liturgiques qu’il a promulgués – qu’il a personnellement et légitimement approuvés en détail – valaient le sacrifice de rites liturgiques vénérables. Il croyait sincèrement qu’ils apporteraient un nouveau printemps dans la vie de l’Église de son temps. Les livres liturgiques qu’il a promulgués font incontestablement autorité. Les sacrements célébrés par eux sont valides. Mais, étant donné qu’ils sont allés au-delà du mandat du Concile, il est historiquement et liturgiquement vrai de dire que ce sont les livres liturgiques de Paul VI, et non du Concile Vatican II. Et sur cette base, il est légitime de s’interroger sur leur continuité avec la tradition liturgique.
Le nouvel usage, plus récent, du rite romain (l' »usus recentior« ) est une innovation, jugée opportune par l’autorité suprême. Sa compétence pour le faire est une autre question, notamment à la lumière de l’enseignement du Catéchisme de l’Église catholique :
C’est pourquoi aucun rite sacramentel ne peut être modifié ou manipulé au gré du ministre ou de la communauté. Même l’autorité suprême dans l’Église ne peut changer la liturgie à son gré, mais seulement dans l’obéissance de la foi et dans le respect religieux du mystère de la liturgie. (CEC 1125)
Plus tard au cours de son pontificat, Paul VI eut des doutes. Son licenciement sommaire en 1975 de l’architecte clé de la réforme (et alors archevêque) Bugnini, et son traitement sévère de ceux qui s’opposaient à la réforme peuvent en être considérés comme des symptômes. Le nouveau printemps attendu dans la vie de l’Église ne s’est pas matérialisé, comme les statistiques ne le démontrent que trop bien. Certes, de nombreux facteurs sociologiques ont contribué à la gravité de la crise, mais il n’en reste pas moins que la « nouvelle » liturgie tant vantée n’a pas produit les résultats promis par ses architectes. La participation aux rites liturgiques a rapidement diminué pour la raison très simple que la participation première et la plus nécessaire est d’être présent. De plus en plus, les gens ne vinrent plus du tout.
Réformes sous Saint Jean-Paul II et Benoît XVI
Saint Jean-Paul II, élu en 1978, chercha à promouvoir une mise en œuvre plus stricte des livres liturgiques réformés – il dénonca fortement les abus – et en 1984, une permission limitée a été accordée pour l’usus antiquior comme moyen d’apaiser les divisions qui s’étaient durcies sous Paul VI. Cette permission a été élargie en 1988 en réponse à la consécration illégale d’évêques par Mgr Lefebvre mais également, et de manière significative, parce que le pape a reconnu les « aspirations légitimes » de ceux qui étaient attachés aux réformes liturgiques précédentes. Cette reconnaissance a facilité la formation d’instituts, de paroisses personnelles et d’autres communautés dont l’usus antiquior était (et est) l’élément vital. La participation pleine, consciente et effective aux rites liturgiques dont témoignent ces communautés jusqu’à aujourd’hui – dont les Pères du Concile seraient fiers – a porté des fruits significatifs depuis lors, notamment en attirant les jeunes et en suscitant des vocations au sacerdoce et à la vie religieuse.
Le bras droit de Jean-Paul II pendant deux décennies, le cardinal Joseph Ratzinger, reconnaissait cette réalité et comprenait la question plus large de la nécessité de s’attaquer à la rupture de la tradition liturgique de l’Église. Il a entrepris deux initiatives. En tant que cardinal et en tant que théologien privé, il a souvent écrit et parlé de la nécessité d’un nouveau mouvement liturgique pour retrouver le véritable esprit de la Liturgie. Et il a parlé de l’opportunité d’une « réforme de la réforme liturgique », pour corriger en quelque sorte les livres liturgiques de Paul VI.
La première initiative était suffisamment générale pour ne pas inquiéter les partisans du missel de Paul VI ; mais la proposition concrète de retoucher et d’améliorer l’usus recentior était, pour eux, la goutte qui fait déborder le vase. Même après son élection à la papauté, l’évocation d’une éventuelle « réforme de la réforme » a été interdite dans les murs de sa propre Congrégation pour le Culte Divin, ce qui a concrètement bloqué sa mise en œuvre. L’occasion perdue par l’insistance rigide sur le caractère irréformable des livres liturgiques de Paul VI ne sera peut-être pas bien jugée par l’Histoire.
En tant que pape, Benoît XVI a agi selon ses convictions et, en 2007, a exhorté l’Église à une célébration plus digne de l’usus recentior en continuité avec la tradition liturgique (avec l’exhortation apostolique Sacramentum caritatis). Quelques mois plus tard, par le motu proprio Summorum Pontificum, il a établi que l’usus antiquior avait sa juste place dans la vie liturgique de l’Église et l’a libéré de l’emprise tatillonne des évêques qui avaient, en de trop nombreux endroits, cherché à l’étrangler.
En conséquence, la croissance stimulée par Jean-Paul II s’est accélérée. Une coexistence liturgique pacifique s’est développée dans de nombreux diocèses. Un certain enrichissement mutuel entre les usages commença à se développer. Les évêques en visite ont rencontré des communautés jeunes, dynamiques et apostoliques – parfois en contraste frappant avec d’autres communautés dans leur diocèse.
Ces actes de Benoît XVI étaient-ils contraires au Concile ? Pour ceux d’entre nous qui sont trop jeunes pour y avoir assisté, il est difficile de le dire. Nous n’avons pas travaillé quotidiennement avec ses Pères, ni participé à la rédaction de ses documents. C’est Benoît XVI qui l’a fait. Et il a consacré son ministère théologique et épiscopal à son interprétation dans une herméneutique de la continuité, et non de la rupture – ce qui est certainement la seule façon valable d’interpréter ses réformes. De même, les discours et les documents de Benoît XVI font constamment référence au Concile, bien plus que ceux de son successeur. Il ne s’agit pas de critiquer le Saint-Père, qui a sa propre approche, mais simplement de constater que l’enseignement de Benoît XVI est tout à fait conciliaire, même s’il n’est nullement déformé par la croyance idéologique que l’Église (ou une nouvelle Église) a commencé à Vatican II. Si les actes de Benoît XVI sont perçus comme contraires au Concile, c’est parce qu’ils ont contesté et corrigé ce « Concile » d’idéologues et sa progéniture avec la réalité historique et théologique.
Ce qui est significatif – et cela fut une surprise pour beaucoup – c’est que le pontificat de Benoît XVI l’a révélé comme un professeur doux et paternel, plutôt généreux envers ceux qui avaient des opinions différentes des siennes. Il ne sanctionnait pas sévèrement ceux avec qui il était en désaccord. Il a plutôt cherché à les enseigner, souvent par l’exemple. Sur le plan liturgique, tout en célébrant lui-même bien l’usus recentior, il reconnaissait et respectait l’importance de l’usus antiquior dans la vie de l’Église du XXIe siècle, et en particulier son attrait pour les jeunes. La richesse qu’est une diversité dans l’unité était une réalité dans de nombreux diocèses, et était valorisée.
Lors de la démission du Pape Benoît, il était inimaginable qu’un successeur puisse annuler Summorum Pontificum. Et pourtant, c’est ce qui s’est passé. Pourquoi ?
La réalité virtuelle vs les faits sur le terrain
La motivation déclarée est de protéger d’urgence l’unité de l’Église, qui est menacée par les attitudes et les propos de traditionalistes qui mérpisent le Concile. Il est vrai qu’il existe de bruyants « tradicaux », qui pontifient à loisir sur n’importe quel aspect de la foi ou de la Sainte Liturgie avec un aplomb qui vous coupe le souffle par sa présomption, son arrogance ou son ignorance. Et oui, il y a les « tradis professionnels » qui ne peuvent s’empêcher de publier (et monétiser) tout ce qui leur passe par la tête, et prétendent déterminer ce que les médias catholiques disent, ou même se dispenser de la loi liturgique, sur la base de leur propre jugement privé. Il y aussi les « liturgistes d’Internet » qui feraient mieux de se trouver un séminaire ou un monastère mais qui, par leur propre faute ou par celle des autres, se trouvent seulement capables de discourir sur la liturgie plutôt que de la vivre, et qui finissent dans un monde liturgique qui leur est propre, basé sur leurs préférences personnelles, souvent assez excentriques.
Si ces personnes fomentent le négationnisme ou la division, c’est virtuellement. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas grave, surtout quand on connaît la capacité de la réalité virtuelle à influencer les esprits. Mais, comme de nombreux évêques du monde entier l’ont attesté ces dernières semaines, cela ne correpsond pas à la réalité de terrain, vécue par les communautés qui vivent une vie liturgique et apostolique tangible, centrée sur la participation fructueuse aux richesses de l’usus antiquior. Ce qu’il faut, ce n’est pas un décret ordonnant la disparition de ces personnes, mais la mise en place de centres de vie liturgique intégrale qui puissent attirer ces gens des marges vers le cœur de la communion de l’Église, avec miséricorde, charité et, oui, quand c’est nécessaire, en les corrigeant. Réagir de manière excessive à ce problème ne fait que révéler son propre malaise. Cela contribue également à justifier leur point de vue et à donner de l’eau à leur moulin.
De nombreux évêques, y compris certains qui ne sont pas vraiment des amis de l’usus antiquior, ont été prompts à se montrer pastoralement ouverts suite aux mesures édictées par Traditionis custodes. Cela peut être simplement parce que ces mesures sont intenables, ou inapplicables, aux yeux d’évêques diocésains qui ont de vrais problèmes à gérer. C’est aussi souvent parce qu’ils savent que le problème qui motive cette législation n’existe pas dans leurs diocèses. La « non-réception » généralisée de ce Motu Proprio par l’épiscopat pourrait elle-même s’avérer être un moment historique d’importance dans l’histoire liturgique et papale.
Il semble cependant que certains, au sein de la Curie romaine, croient sincèrement que Traditionis custodes entraînera la disparition de l’usus antiquior de l’Église. Avec tout le respect dû à leurs Éminentes, Excellentes et Très Révérendes personnes, ils sont aussi déconnectés de la réalité qu’ils le sont des faits historiques. L’obéissance aveugle et suicidaire n’est plus réellement dans l’air du temps. Il se peut qu’ils ravivent les guerres liturgiques et poussent les gens à la clandestinité ou à sortir des structures ecclésiastiques ordinaires ; il se peut qu’ils frustrent et même détruisent des vies chrétiennes et des vocations ; il se peut qu’ils aggravent la division dans l’Église au nom de la prétendue protection de son unité (et pour tout cela, ils devront rendre des comptes à Dieu Tout-Puissant), mais cela ne fera que souligner l’importance et la valeur cruciale de l’usus antiquior dans la vie de l’Église d’aujourd’hui et de demain. De même, la nécessité perçue de recourir à des mesures aussi drastiques pour « protéger » l’usus recentior quelque cinquante ans après sa promulgation est, peut-être, son plus grand désaveu.
Certains prélats pourraient se réconforter en répétant le mantra selon lequel le Missel de Paul VI est « un témoin d’une foi inchangée et d’une tradition ininterrompue », comme un article de foi. Mais ce n’est pas vrai dans les faits. Le besoin d’employer un tel langage pour affirmer la continuité là où elle est manifestement absente révèle que celui-ci relève, en fait, de la propagande. Que le Missel de Paul VI contienne des différences théologiques et liturgiques substantielles et intentionnelles par rapport à celui de saint Jean XXIII est une chose sur laquelle les réformateurs post-conciliaires eux-mêmes, les supporters honnêtes et intelligents de l’usus recentior d’aujourd’hui, et ses critiques, sont tous d’accord. Traditionis custodes lui-même, en supposant que l’usus antiquior n’a pas sa place dans l’Église post-conciliaire, l’affirme implicitement.
S’il est vrai que le nouveau Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin a été un acteur clé (ou un pion ?) dans la production de ce Motu Proprio, et s’il est vrai qu’il s’est vanté que sa clique parviendrait à annihiler Summorum Pontificum, alors il est clair que cela fait partie d’une campagne orchestrée. Le Saint-Père a-t-il été induit en erreur, voire abusé, par certains zélateurs ? Ou bien souffre-t-il d’un profond malentendu historique sur ces questions ? Nous devons redoubler nos prières pour lui et pour l’Église. La messe votive pour l’unité de l’Église ne doit pas être ignorée en ces jours.
Conclusion
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas un traditionaliste. Je suis un catholique. Et en tant que catholique, je considère que l’amertume, la peur, l’aliénation et la division croissante directement provoquées par Traditionis custodes sont une situation extrêmement préoccupante. C’est une source de scandale bien au-delà de ceux qu’elle vise et, pastoralement parlant, c’est déjà un désastre – en particulier chez les jeunes.
Face à cela, en tant qu’historien de la liturgie, je ne peux rester silencieux. La législation ne peut pas changer les faits historiques. Un acte de positivisme juridique ne peut pas non plus déterminer ce qui fait ou ne fait pas partie de la lex orandi de l’Église, car comme l’enseigne le Catéchisme, » la loi de la prière est la loi de la foi : l’Église croit comme elle prie. La liturgie est un élément constitutif de la Tradition sainte et vivante » (par. 1124) – dont les évêques, et en premier lieu l’évêque de Rome, sont les gardiens, et non les propriétaires. En effet, comme l’enseigna un humble Pape lorsqu’il prit possession de sa cathédrale à Rome :
Le Pape n’est pas un souverain absolu, dont la pensée et la volonté font loi. Au contraire: le ministère du Pape est la garantie de l’obéissance envers le Christ et envers Sa Parole. Il ne doit pas proclamer ses propres idées, mais se soumettre constamment, ainsi que l’Eglise, à l’obéissance envers la Parole de Dieu, face à toutes les tentatives d’adaptation et d’appauvrissement, ainsi que face à tout opportunisme.
Ce même pape était un étudiant assidu de la théologie et de l’histoire de la liturgie. Cela l’a amené à conclure que :
« Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. »
Il insiste :
« Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place. «
Toute autre conclusion trahit une ignorance fondamentale les bases de l’histoire de Liturgie. Elle n’est guère davantage fondée dans une saine théologie ou pastorale.
[1] Pour un examen plus détaillé de ces questions et les références bibliographiques associées, voir mes deux ouvrages, The Organic Development of the Liturgy (Ignatius, 2005 [NdT : Traduction française à venir]) et le T&T Clark Companion to Liturgy (Bloomsbury, 2015).